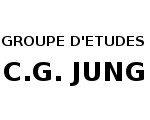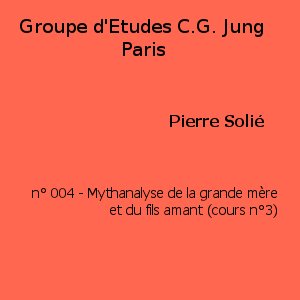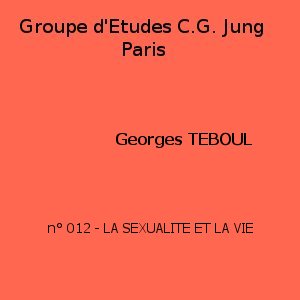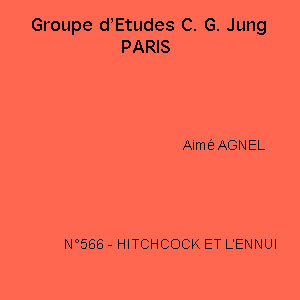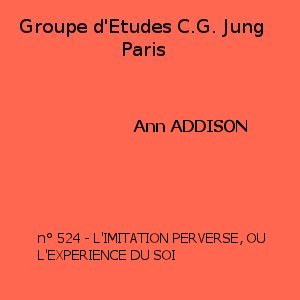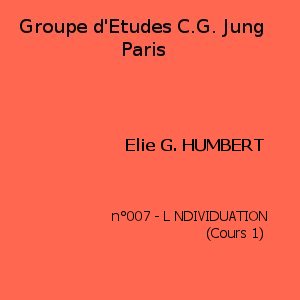SOLIE Pierre : MYTHANALYSE DE LA GRANDE MÈRE ET DU FILS AMANT (Cours N°3)
Description
Lot-004 – SOLIE Pierre : MYTHANALYSE DE LA GRANDE MÈRE ET DU FILS AMANT (Cours N°3)
Mythanalyse 3 résumé (fichier 004 cours n*3)
Dans cette conférence, Pierre Solié explore les grands mythes de la possession divine, du chaos et de la transgression, en s’appuyant sur Les Bacchantes d’Euripide, le mythe de Cybèle et Attis, et la figure d’Héraclès frappé de folie. Il met en lumière un principe fondamental : le refus des forces dionysiaques conduit à la destruction, car ce qui est nié dans la psyché finit par se manifester sous une forme incontrôlable.
Le récit s’ouvre sur Dionysos et son affrontement avec Penthée. Thèbes rejette la divinité du dieu et tente d’imposer l’ordre rationnel contre l’extase et la métamorphose. Penthée, roi solaire, incarne cette rigidité, mais son refus de Dionysos le piège : il bascule dans la confusion et finit massacré par sa propre mère, Agavé, dans un état de transe bacchique.
Solié établit un parallèle avec Héraclès, figure de la force et de l’ordre. Après son expédition contre Eurysthée, son double mythologique, il rentre marqué par l’échec. La mania, la folie sacrée dionysiaque, s’abat alors sur lui. Une musique étrange s’élève – flûtes, tambourins et cymbales –, annonçant le basculement. Pris d’une hallucination, il massacre ses propres
enfants, pensant tuer ceux de son ennemi.
Enfin, Solié aborde le mythe de Cybèle et Attis, où se retrouve la même tension entre l’ordre social et une force archaïque incontrôlable. Cybèle, déesse de la nature sauvage, incarne une puissance primordiale qui défie l’organisation rationnelle du monde grec. Son culte est marqué par la possession, l’extase et la mutilation, dans une logique de destruction et
renaissance, comparable à celle de Dionysos.
Le mythe de Cybèle et Attis
Zeus, pris d’un désir incontrôlable pour Gaïa-Cybèle, est rejeté par elle. Dans un acte archaïque, il éjacule sur la Terre-Mère, et de cette semence naît Agditis, un être hybride et excessif, à la fois masculin et féminin. Les dieux, effrayés par sa puissance, envoient
Dionysos pour le neutraliser.
Dionysos l’enivre jusqu’à l’ivresse totale, puis passe une corde autour de son sexe, la fait glisser sur une branche d’arbre et tire brutalement, le castrant. Lorsque son sexe tombe au sol, il éjacule, et de cette semence naît un amandier, dont le fruit sera à l’origine d’Attis.
Nana, fille du dieu-fleuve Sangarios, recueille une amande de cet arbre et la place sur son sein, ce qui la féconde. Son père, furieux, la punit, et Attis, à sa naissance, est abandonné. Recueilli par des bergers, il grandit et est fiancé à la fille du roi de Pessinos (parfois identifié à Midas).
Mais lors du mariage, Cybèle provoque une folie collective : Attis et d’autres hommes se castrent, et Attis en meurt.
Chaque année, ce mythe était revécu dans le culte de Cybèle, notamment lors du Jour du Sang (dies sanguinis), le 24 mars. Ce jour-là, les prêtres Galles se livraient à des danses extatiques et à des automutilations rituelles, rejouant le sacrifice d’Attis pour assurer la renaissance du printemps.
Cybèle et Attis : un amour accompli ou impossible ?
Selon les versions du mythe, Cybèle et Attis sont soit amants, soit liés par un amour impossible. Dans certains récits, Cybèle entend parler de la beauté d’Attis et en tombe amoureuse, mais lorsque celui-ci s’apprête à épouser la fille du roi Midas, elle, par jalousie, déclenche la mania qui conduit à sa castration et à sa mort.
Dans d’autres versions, Cybèle impose la chasteté à Attis, mais ce dernier tombe amoureux d’une nymphe, provoquant sa colère. Quelle que soit la version, la relation entre Cybèle et Attis est marquée par la passion et la tragédie, et les rituels du printemps semblent bien être un hommage à cet amour perdu.
De l’hominisation à l’humanisation
Solié inscrit ce mythe dans une réflexion plus large sur le passage de l’hominisation à l’humanisation, une transition qui marque le passage de la fémélité à la féminité, et de la malité à la masculinité.
Enfin, il approfondit la notion de double et de complémentaire, estimant que Jung n’a peut-être pas exploré pleinement ces dynamiques en s’arrêtant aux concepts d’anima et d’ombre.
Selon lui, ces notions mériteraient d’être repensées pour mieux comprendre les structures profondes de la psyché.